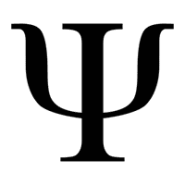Nous avons terminé le dernier entretien sur une question : pourquoi, malgré ce qu’on a dit précédemment de la démarche scientifique et de ses bases, arrive-t-on aujourd’hui à lire, voir, ou entendre, dans les journaux, sur le Web, à la télévision ou même dans des journaux spécialisés, le résultat d’études scientifiques qui se contredisent, partiellement ou totalement?
Le doute dans la démarche scientifique
En fait, les réponses à cette question sont multiples, et soulignent encore, s’il le fallait, le rôle essentiel du doute, encore plus dans notre société du début du XXIe siècle. Nous allons maintenant essayer de cerner un peu ces réponses.
Tout d’abord, comme on l’a expliqué, le doute est une partie intégrante d’une démarche scientifique, et aucune théorie scientifique ne peut être qualifiée de «Vérité», simplement elle est temporairement vraie jusqu’à ce qu’une autre pointe ses faiblesses et ne la remplace. En gardant ceci en tête, il apparaît donc normal que des hypothèses ou théories n’aient qu’une durée de vie limitée.
Plusieurs phénomènes viennent profondément modifier ou amplifier ce mécanisme de base.
Tout d’abord, historiquement, jusque vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les scientifiques étaient un petit nombre seulement dans le monde, comme on l’a expliqué, et avaient suivi un parcours qui en faisaient des «savants», dans le vrai sens du terme : ayant souvent commencé par des études de théologie et l’apprentissage de langues mortes, ils savaient lire les ouvrages des périodes passées dans la langue originale, avaient appris la philosophie, les mathématiques, la médecine, et étaient donc capables de réfléchir de manière différente, ouverte et très critique, que ce soit par rapport à ce qu’ils faisaient ou à ce que faisaient leurs collègues. Ils avaient une vue d’ensemble.
Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et encore plus depuis les années 1990, les Universités se sont remplies, de plus en plus d’étudiants s’y sont inscrits, à tel point qu’aujourd’hui dans certains pays plus des 2/3 des jeunes y sont inscrits, de très nombreux laboratoires de recherches y ont vu le jour. Ceci a 2 conséquences directes : la quasi-totalité de ces étudiants n’a pas cette approche multidisciplinaire, et est donc beaucoup plus spécialisée et moins critique que leurs aînés. Mais aussi les fonds nécessaires au fonctionnement de ces laboratoires ont explosé, à cause du nombre et de laboratoires et d’étudiants. Ce qui fait que les laboratoires sont en compétition pour obtenir des fonds, qui pour la plupart proviennent des États, et éventuellement de grosses entreprises privées. Et qui dit compétition dit «devoir se faire remarquer».
D’accord. Mais en quoi ce que tu viens de dire peut-il donner des résultats scientifiques qui paraissent se contredire, ou se contredisent réellement ?
Le premier aspect, c’est-à-dire le nombre et la spécialisation des étudiants et des laboratoires, provoque une diminution de l’aspect «théorique» au profit de l’aspect «pratique» : au lieu de chercher à établir ou publier une théorie, on va chercher à publier un résultat d’expérience. Évidemment on va en avoir beaucoup plus, car il est beaucoup plus facile de faire une expérience que de construire une théorie. L’inconvénient majeur, c’est que du coup on peut beaucoup plus difficilement en tirer un résultat général… Or, comme on avait précisé précédemment, la démarche scientifique se base sur le fait aussi de faire des prédictions. Si l’échantillon est trop restreint, il est tout à fait possible qu’on ne puisse pas faire de prédictions, ou qu’elles soient potentiellement fausses. On peut donc assez facilement avoir des résultats différents ou contradictoires entre plusieurs équipes.
Le second aspect, la compétition entre les différents laboratoires, va entraîner plusieurs conséquences qui vont dans le même sens que ce qu’on vient de dire : on va faire des expériences plutôt que des théories, on va peut-être les faire avec un échantillon réduit, autant pour ne pas trop dépenser d’argent que pour gagner du temps, et surtout on va vouloir les publier vite, voire en faire de la publicité directe, en réduisant du même coup et les temps de réflexion et/ou autocritique, et les possibilités de résultats différents.
Et cet aspect est énormément renforcé par notre société technologique actuelle : le Web, qui permet à chacun, et donc à ces laboratoires, de faire leurs publicités directement. La multiplication des sites ou blogues faits par n’importe qui, la mondialisation et multiplication de revues soi-disant spécialisées, mais qui en fait ne sont pas vraiment sérieuses (dans lesquelles par exemple c’est l’auteur qui paye pour la publication, et sont donc en fait des supports publicitaires déguisés), mais aussi la course à l’information de tous les médias, sérieux ou non, qui leur fait souvent publier des informations sans qu’il y ait vraiment de vérification, ou bien changer les titres pour en faire quelque chose d’accrocheur, voire de racoleur.. (un exemple récent en astrophysique a été de modifier le titre d’un article de «observation de la mort d’une étoile» en «observation d’une Étoile de la Mort», ce qui est fondamentalement différent).
Oui, c’est vrai que ça change tout… Mais alors, que doit-on croire de ce qu’on lit ou voit dans des journaux, à la télé, ou sur le Web?
Tout ceci conduit à renforcer encore l’acuité au doute, qui, auparavant limité à la communauté scientifique, doit maintenant être envisagé comme une nécessité absolue de survie pour tout un chacun dans notre société technologique, bombardée que nous sommes d’informations et de «faits» ou «études» qualifiés de «scientifiques».
Et d’ailleurs ceci est vrai aussi dans ton domaine de la psychologie. J’ai lu récemment que 300 experts mondiaux en psychologie avaient examiné les publications d’une revue internationale, je crois pour l’année 2008. Sur l’ensemble de ces publications, seulement 30% s’avéraient vérifiables et reproductibles, et ceci même si elles étaient le fait d’un spécialiste reconnu, en grande partie pour les raisons énoncées plus haut.
Par contre, bien entendu, il faut exercer ce doute de manière éduquée, sensée. Sinon on peut douter d’absolument tout, et croire aux théories complotistes ou conspirationnistes. Or il y a quand même des certitudes absolues, comme le fait que l’Homme a posé le pied sur la Lune, que le Soleil existe, que les civilisations il y a 4000 ans ont réellement existé, et pas dans des films de science-fiction, que ce sont bien des vrais avions qui ont réellement détruit les t urs Jumelles à New York en 2001… En fait, c’est même le contraire : les théories conspirationnistes ou complotistes se propagent aujourd’hui sur Internet grâce justement à une mauvaise compréhension de ce qu’est le doute, en oubliant les racines scientifiques de ce doute….
Ça me donne un excellent tremplin pour pouvoir maintenant te questionner à mon tour sur ta vision de la psychologie comme science et son évolution.