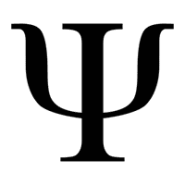Maintenant, toutes les connaissances et théories actuelles, qui nous permettent d’avoir la vision de l’Univers que l’on a, et dont on a parlé dans les vidéos précédentes ont été affublées de l’adjectif «scientifique»… Mais qu’est que une «théorie scientifique», ou «une démarche scientifique»?
En gros et pour résumer, depuis les Grecs, avec par exemple Pythagore ou Eratosthène, puis Copernic, Galilée, Newton, et enfin au XVIII siècle avec en particulier Diderot et D’Alembert, on a établi la vision de la science moderne, qui ne veut pas d’«explication divine», du genre «c‘est comme ça», «c’est Dieu». Il faut des preuves à ce qu’on avance. Une démarche, un processus, est donc nécessaire afin d’affirmer une «théorie» à partir de «preuves»: on commence par observer un ou des phénomènes naturels… On y réfléchit, et on construit une théorie, c’est-à-dire qu’on bâtit une construction intellectuelle, qui permet d’expliquer le ou les phénomènes étudiés. Pendant que l’on fait cela, on essaye de prendre en compte des critiques potentielles que d’autres pourraient faire, en tentant de se faire, comme on dit habituellement «l’avocat du diable». Ceci afin de vérifier si la «théorie» résiste aux critiques qu’on peut imaginer… Ensuite on tente de prédire des observations que l’on pourrait faire, qui pourraient confirmer cette théorie…
La démarche scientifique
C’est ce processus que l’on appelle «une démarche scientifique». Bien entendu, si les observations prédites ou une critique non prévue contredisent les prédictions de la théorie, elle est alors à revoir, quelquefois partiellement, quelquefois totalement.
Le principe de fond ici est qu’il suffit d’UNE exception, d’UN SEUL contre-exemple, pour que la théorie devienne invalide.
Le processus scientifique est donc un long cycle de tentatives d’explication du monde qui nous entoure, suivi de prédictions, et, souvent, de destruction ou de refonte des théories précédentes.
En fait, la moitié du travail des scientifiques est de tenter de confirmer ou infirmer les théories passées ou établies par d’autres, l’autre moitié est d’en construire une eux-mêmes. Pour cela, le doute est un outil puissant et omniprésent dans la démarche scientifique: si, plus on avance, plus tous les obstacles que l’on tente de dresser devant une théorie s’expliquent finalement, alors la théorie devient de plus en plus forte… Quand un scientifique échafaude une théorie, tous les autres commencent par douter, et essayent de la démonter. Si, génération après génération, ils n’y arrivent pas, alors elle en sort d’autant plus renforcée.